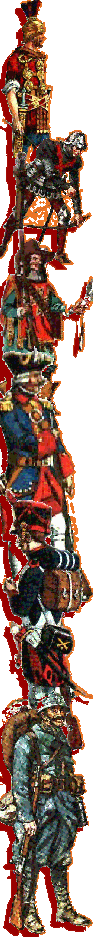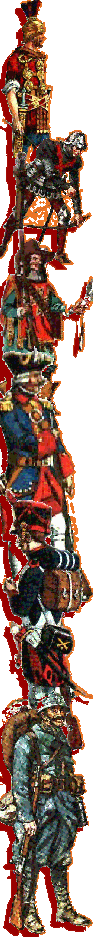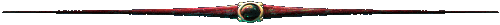
On suppose que l’origine
du village serait contemporaine de la période
gallo-romaine, c’est à dire dans les
premiers siècles de notre ère. Le nom le plus
ancien connu est MERCURINGA, dérivé de mercure,
dieu des Romains.
Il se trouvait
donc à Mécrin, un temple dédié à ce dieu. La
citation la plus ancienne remonte au IX° siècle,
sans autre détail.
Comme la plupart
des localités, le nom a changé plusieurs fois
au cours de l’histoire : après
Mercuringa, ce fut MECRAIGNE, MAICRIN, MECRAIN
puis le nom actuel de MECRIN. (Il y eut aussi
MESCRIGNES).
En 1226, l’église
avait été donnée par Jean d’Apremont, aux
chanoines réguliers de ST-Nicolas de Verdun. En
ces temps là, de continuelles transactions :
ventes, échanges, achats et dons, legs et droits
de pays et d’églises étaient très
courants. Quelques écrits ont subsisté,
permettant de mieux situer l’existence de
certains lieux.
Vers 1373/76,
lors du siège de Sampigny (il n’est pas dit
par qui le village de Mécrin fut entièrement détruit
et brûlé.)
En 1380, un don
de 40( ?), on ne sait pas !, est fait
aux habitants pour aider à la reconstruction et
y édifier un fort qui fut commencé sur ordre du
Duc de Bar en 1387. Ce fort était important avec
des fossés profonds et larges ou des hommes de Mécrain
(forme de conscription) était obligés de monter
la garde jour et nuit, ceci après avoir été
contraints de faire de même au château de Saint-Mihiel.
En 1406, un écrit
parle de délivrance de pain aux compagnons et
gens d’armes de messire Jean de Verzy,
cantonnés là avec plusieurs centaines de
chevaux.
En 1578/79,
sondage de la Meuse entre Mécrin et Sampigny, en
vue d’y établir un pont.
Il est question
plusieurs fois à Mécrin, de rassemblement d’hommes
de guerre, sans autres détails.
Mécrin,
jusqu'à la révolution, fit partie du Barrois
non mouvant, dépendant du doyenné d’Hattonchâtel,
bailliage de Saint-Mihiel.
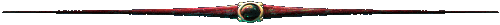
MECRIN:
"MERCURIUS" ?
Quelques
historiens font venir le nom de ce village de
Mercurius, Mercure, le Dieu du commerce mais
aussi des voleurs. Une statuette en bronze trouvée
dans la rivière lors des travaux exécutés au
pont de "Pont-sur-Meuse" (village
voisin de Mécrin) semblait leur donner raison en
justifiant que ce dieu était jadis commun chez
les habitants, comme le sont les christs
d'aujourd'hui. Ils ignoraient sans doute que le
nom originaire du village n'était pas Mécrin,
mais Mescrigne, ce qui dérange un peu leurs
hypothèses.
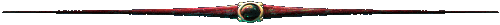
Le
plus ancien acte connu relatif à Mécrin est la
donnation de cure de ce lieu au chapitre de
Verdun par l'évêque Jean D'Apremont en 1211.
Durant
les temps calamiteux de ce siècle, le village
ruiné fut abandonné, ce qui fit consentir par
le duc, en 1374, la remise de moitié de sa
redevance au maire pour son office, ainsi qu'à
Estevignon, échevin, et à Jean Martin, doyen.
On sait que les officiers payaient le droit
d'exercer leur ministère, mais aussi qu'ils
percevaient certaines rétributions qui excédaient
le prix de leurs charges. En 1380, la peste ayant
attaquée le peu d'habitants, le Duc leur céda
moitié de la "taille". L'année
suivante on le voit faire remise de huit florins
à la dame Rondette, veuve du maire Mauparge,
victime du fléau. Il remit également à Colet
Raulin, doyen à ce moment, moitié de la
redevance de son office.
Mécrin,
placé en plaine, n'avait aucune défense, ce qui
avait facilité toutes les entreprises sous
lesquelles il avait succombé. En1387, le Duc
ordonna d'y élever une forteresse pour la
constrution de laquelle il fallut prendre une
maison appartenant aux chanoines de Verdun qui se
hâtèrent de réclamer. Dans la crainte d'un
procés qui aurait retardé les travaux, le Duc
leur constitua une rente de 100 sous, dont il mit
60 francs d'or. Pour les 40 sous restants, le Duc
leur donna 3 fauchées trois quart de près à
Koeur et Menonville. La garde en fut confiée aux
habitants qui, en retour, furent déchargés de
celle qu'ils étaient obligés de faire au château
de Saint-Mihiel. Cette forteresse était un lieu
de refuge dont l'enceinte existe encore à l'extrémité
du village, près de la Meuse. On le connaît
depuis longtemps sous la dénomination de "la
Cour". C'était en effet, une vaste cour
autour de laquelle étaient construites des
habitations assez médiocres, adossées au mur de
l'enceinte, au nombre desquelles en étaient une
pour le curé. Trop restreintes pour un usage
ordinaire et continu, elles n'étaient destinées
qu'à un refuge momentané contre les rôdeurs
qui guerroyaient en bandes détachées sans engin
de siège. Dans les temps de troubles un guetteur
avertissait les interéssés épars dans la
campagne, au moyen d'une cloche d'alarme.
L'habitude d'y obéir incontinent avait passé
des hommes aux animaux, car on raconte qu'à ce
signal les troupeaux se hâtaient d'accourir et
de rentrer. Cette pauvre forteresse, à en juger
par sa construction en simples moellons, quoique
les murs eussent quatre à cinq pieds d'épaisseur,
était défendue par un fossé régnant tout à
l'entour, alimenté par le ruisseau. Les
contemporains ont le souvenir que l'on y entrait
que par un pont levis.
On
à vu par la suite des projets de guerre des Ducs
de Bar contre la ville de Metz, en 1407, Mécrin
devint le rendez-vous de grand nombre de troupes;
le 25 juillet, on y comptait 900 chevaux qui équivalaient
à peu près à 10 000 hommes, lesquels, malgrè
leur qualité d'alliés du Barrois présentaient
autant d'inconvénients qu'eût pu le faire une
invation véritable, eu égard au chiffre peu élevé
de la population.
En
1418, le cardinal Louis de Bar fit cession à la
comtesse de Ligny, sa soeur, de l'usufruit de Mécrin,
en gage de 100 moutons d'or qu'elle lui avait
avancés.
Le
seigneur de Sampigny prenait la taille ordinaire
fixée à 70 francs, outre deux boisseaux
d'avoine pour chaque habitant, excepté ceux
demeurant dans les rues Notre Dame et de Saint-Mihiel
et avec cela deux poules. Le terrage était au
sixième sur six quarts de terre et le pré de l'île.
Ils n'avaient que le 24° des dîmes. En 1765, la
communauté décida que chaque habitant ne
pourrait avoir que 6 oies et 12 oisons, les
veuves 4 oies et 9 oisons; c'était alors une
richesse pour chacun.
Le
17 février 1727, le Duc vendit la terre de Mécrin
à monsieur René d'Issoncourt, pour l'unir au
comté de Sampigny.
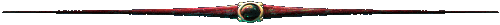
 Bréves historiques de 1357
à nos jours. Bréves historiques de 1357
à nos jours.
(
d'aprés les archives départementales )
1357-58:
rassemblement d'hommes de
guerre à Mescrignes, Vautier II, abbé de Saint-Mihiel
(1252-1279) et Jean commandeur de Marbole (Marbotte:
village voisin de Mécrin) firent un échange qui
consistait en ce que Emmeline, du village de
Maicrain, femme appartenant à cet abbé,
appartiendrait dans la suite du commandeur, elle,
ceux et celles qui en descendraient en place
d'Ozanne, aussi femme de Maicrain, qui fut cedée
à l'abbé avec toute sa postérité. L'échange
est de 1264.

1373-76:
destruction et incendie de Mécrin, pendant le siège
de Sampigny.

1406-08:
délivrance de pain "aux
compagnons et gens d'armes de messire Jean de
Verzy et deux comtes d'Allemagne qui étaient logés
au lieu de Mescrignes à route d'environ IX cents
chevaux"

1457-59:
don de 100 à Marie, femme de Colin le Tinzat, de
Mescrin, nourrice de madame Yolande.

1578-79:
sondage de la Meuse entre Mecrin et Sampigny pour
savoir s'il est possible d'y établir un pont.

1627-32:
Jean Richier, demeurant à Mécrin, paye pour la
finance de son état de notaire la somme de six
écus.

1781:
le trois juillet demande d'une requête pour la
reconstruction du pont.

1783:
décision de reconstruire le
pont à neuf. Il était jusque là en bois de 130
pieds de longueur. Il y a déjà eu une demande
en 1722. Le Duc Léopold accorde cette faveur à
la communauté.

1787:
pétition pour la reconstruction du pont. L'évêque
de Verdun s'engage à acheter une cloche pour le
presbytère de Mécrin pour la somme de 600
francs.

1832:
abornement de terrains et chemins communaux.

1834:
réparation des chemins communaux, curage des
fossés, élargissement d'un chemin communal sous
le même nom de chemin de la rue Toulot, célébration
de la fête du roi ( Papegai ), le conseil
municipal paye 35 centimes chaque garde national.
Mécrin est débitrice à Sampigny d'une somme de
4000 francs pour contruire un nouveau presbytère.

1838:
le conseil municipal demande les réparations de
l'arc-boutant de l'église. Le conseil municipal
décide de construire une maison pour servir à
la tenue de l'école et au logement de
l'instituteur. C'est l'architecte, M.Lerouge, qui
sera proposé à cet effet. La somme de 4000
francs sera prise dans la vente de réserve.

1839:
le conseil municipal décide d'établir la salle
d'instruction au premier étage. Le logement de
l'instituteur serait au rez de chaussée, sous la
salle avec le corridor, et l'escalier serait à côté
du corridor au bout duquel on placerait le
cellier et l'écurie. Le four se trouverait sous
l'escalier. La salle regreffe sera habitée par
l'instituteur. Le conseil municipal demande des
domages et interets pour le feu dans les bois
censitaires.

1852:
les affouages se fixent à douze cents francs à
diviser entre les affouagistes. Le mètre de bois
est fixé à 0,20 franc. Le maire propose une
imposition communale pour le traitement du garde
champêtre.
Le
3 octobre, délibération demandant
l'autorisation de poursuivre M. Paillot ( propriétaire
des founeaux à Vadonville ) en justice. Mécrin
a perdu et a du verser 10 francs à M. Paillot.
Vote
pour l'entretien des pompes à incendie.
Contestation
entre la commune et les carrière de pierre de
taille. La fabrique n'est propriétaire de la
carriére ouverte que pour prescription, ce que
l'on ne conteste pas, mais la commune n'est point
dépossédée du terrain qui l'environne. Un
arrangement est fait avec la fabrique en lui
accordant, sur le loyer, une somme de 100 francs
et le surplus de cette somme rentrera dans la
caisse municipale, si le loyer ne s'élève pas
à 100 francs, la fabrique seule gérera le loyer
sans autre secours de la part de la commune.
Réparation
des chemins vicinaux , acquisition refusée par
le propriétaire d'un terrain à l'entrée du
village.

1853:
les recettes de l'exercice de l'année ne
pourront couvrir les dépenses qu'au moyen d'une
imposition communale. Curage de la Meuse.

1854:
rétribution scolaire mensuelle de 1 franc, rétribution
scolaire annuelle de 5 francs, traitement de
l'institution 200 francs. Un supplément de
traitement à l'instituteur est accordé pour élever
son revenu à un minimun de 600 francs.

1863:
le capitaine V. Aubriot (né en 1775 ), mort à
88 ans, le 14 mai 1863 est enterré au cimetière
de Mécrin, il était " médaillé de Saint
Hélène".

1886:
le 14 janvier a eu lieu à Commercy
l'adjudication des travaux de la nouvelle église.
L'entreprise a été adjugée à M. Bonnefond de
Bonnet moyennant un rabais de 6% . Le 5 novembre,
bénédiction de la première de l'église.

1920:
recontitution du pont de la Meuse, bombardé
pendant la guerre et reconstruit grâce à un
emprunt.
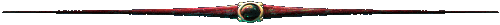
|